 Ouvrage dirigé par Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin – Édition Deuxième Époque.
Ouvrage dirigé par Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin – Édition Deuxième Époque.
Cette enquête sur Les Théâtres documentaires représente une impressionnante somme de travail à travers le double regard des chercheuses Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin qui ont fédéré autour d’elles une vingtaine de contributeurs, et mis en miroir les textes de six personnalités*. L’ouvrage s’inscrit dans un long processus au cours duquel elles ont réalisé des études de terrain, en France et à l’étranger, travaillé sur les archives et analysé de nombreux spectacles auxquels elles ont assisté.
Le point de départ de l’ouvrage – faisant suite à l’avant-propos, et à une longue préface de Béatrice Picon-Vallin – est un manuscrit de l’historien Jacques Legoff, Document/Monument, dans lequel il définit le document comme étant soumis au choix de l’historien, alors que le monument s’inscrit dans le droit fil de l’héritage du passé. Et il précise que la vérité est à construire : « Il n’y a pas, à la limite, de document-vérité. Tout document est mensonge. Il appartient à l’historien de ne pas être le grand naïf. » Suit un texte de Marc Bloch sur la quête d’authenticité et les paradoxes du métier d’historien : « Car les textes ou les documents archéologiques, fût-ce les plus clairs en apparence, ne parlent que lorsqu’on sait les interroger. » La difficulté de définir le théâtre documentaire n’est pas nouvelle, les formes théâtrales relevant de ce concept sont protéiformes, de même que les cinémas documentaires qui émergent dès 1915, ou le web-documentaire d’aujourd’hui, deux médias évoqués respectivement par Martin Goutte et Laurence Allard.
Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin placent leurs recherches dans le fil historique du début du XXème. Ainsi Gerald Stieg fait référence au travail de Karl Kraus (1874-1936) dans Les derniers jours de l’humanité, tragédie publiée en 1919 à Vienne, qui met en exergue son art de la citation et l’utilisation de la photographie, au titre de commentaire satirique ; des extraits du Théâtre politique d’Erwin Piscator (1893-1966) sont présentés, dans lesquels le metteur en scène évoque la notion de drame documentaire. Ce Dokumentarische Drama rivalise avec le journal, dans le but d’approcher, en temps réel, l’actualité au quotidien. La pièce de Peter Weiss (1916-1982), L’Instruction, oratorio en douze chants, emblématique du théâtre documentaire, où l’on juge au cours du Procès de Francfort les seconds couteaux qui ont oeuvré au camp d’extermination d’Auschwitz, est présentée par Jean-Louis Besson. Peter Weiss avait assisté au procès, il part des comptes rendus et des déclarations entendues, qu’il intègre à l’état brut, dans la pièce. C’est l’un des derniers spectacles montés par Piscator, avant sa disparition. En France, Gabriel Garran l’avait présentée au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, en 1967. La même année, le Piccolo Teatro de Milan la mettait à l’affiche dans une mise en scène de Virginio Puecher qu’Erica Magris décrit longuement, la présentant comme un documentaire total : collages, polyphonies, jeu choral, des moniteurs posés à l’avant-scène pour diffuser des images, et un rail, symbole de l’entrée au camp d’Auschwitz tout autant que guide pour la caméra, résument le travail.
L’enquête se poursuit par une observation des formes que prennent les théâtres documentaires dans une dizaine de pays. En Russie, partant de Sergueï Tretiakov (1892-1937) – qui collabore avec le réalisateur Sergueï M. Eisenstein (1898-1948) puis avec Vsevolod Meyerhold, fusillé en 1940 et père du Théâtre de la Révolution – pour lequel il écrivit plusieurs pièces : La terre cabrée, qui mêle divers matériaux documentaires et des écrans, Hurle Chine ! et Je veux un enfant où il fait intervenir les spectateurs. Tretiakov défend les positions les plus radicales de l’avant-garde esthétique soviétique. Dans son article, Kristina Matvienko présente aussi, un siècle plus tard, le Théâtre.doc ouvert à Moscou, en 2002. Avec la participation de jeunes auteurs, metteurs en scène et acteurs, cette plateforme de libre expression des opinions s’est créée autour du premier manifeste des dramaturges Elena Gremina et Mikhaïl Ougarov, et de leur exigence de nouvelle objectivité. Dans les années 60/80 le théâtre documentaire britannique décrit par Erica Magris, témoigne, avec notamment Oh What a lovely War monté par Joan Littlewood et le Théâtre Workshop, en 1963. Ce spectacle à la théâtralité singulière raconte l’histoire d’un soldat du front occidental à travers les chansons populaires de l’époque et l’interaction de différents documents, tels que mémoires de guerre, journal lumineux, jeu dramatique et musique. Pierre Debauche en monte la version française en 1966, sous le titre Ah Dieu ! Que la guerre est jolie… issu d’un vers du poète Apollinaire, blessé en 1916, pendant la guerre. L’auteure évoque aussi Peter Brook, alors directeur de la Royal Shakespeare Company, et son spectacle US sur la guerre au Vietnam. Une approche collective du plateau et une recherche sur le jeu de l’acteur fondent sa démarche. Brook et les acteurs s’interrogent ensemble sur la manière dont l’actualité s’inscrit dans le théâtre. À la fin des années quatre-vingts, The Workers Theatre Movements pratique une sorte d’agit-prop à la manière des avant-gardes des années vingt. Dans les années quatre-vingt-dix, le Théâtre Verbatim, dont Derek Paget définit les origines et les méthodes, défend une dimension locale par son esprit de community theatre, collecte la parole orale en utilisant les méthodes d’entretiens dont se servent les sociologues – enregistrement, transcription, recomposition – et traite de sujets sociaux comme la drogue, la médecine, les migrants etc… Ce mouvement théâtral est même parfois re-créateur d’archives manquantes sur lesquelles les historiens peuvent ensuite travailler. Le théâtre Verbatim, qui a rencontré un vif succès et se poursuit aujourd’hui, a essaimé dans de nombreux pays d’Europe orientale et centrale.
Ainsi, en Roumanie, une multiplicité de démarches et de langages portés par la jeune génération s’est développée, hors des sentiers balisés et officiels, créant une certaine nébuleuse. Mirella Patureau rapporte : « Le faisceau est dense et les fils enchevêtrés. Théâtre alternatif, Théâtre indépendant, Théâtre underground, Théâtre communautaire… Les termes se bousculent, se contredisent, se complètent… et le théâtre-document peut surgir partout. » Elle présente notamment le travail de Gianina Cărbunariu avec le groupe Dramacum qui, en 2009, par le spectacle 20/20, revient sur les heurts entre les communautés roumaine et hongroise de Transylvanie, qui eurent lieu en 1990. En 2011, ayant pris connaissance de certains documents de la Securitate, la metteure en scène présente le spectacle, X mm din Y km – qui se traduit par X mm de dossiers sur Y km de rayonnages d’archives – où elle « colle » aux sources. Elle s’appuie aussi sur un livre-document publié par l’écrivain dissident Dorin Tudoran. Placés au milieu du public, les acteurs tirent au sort leurs rôles, chaque soir, et présentent quatre versions différentes du même texte. Le cas de la Grèce, dont témoigne Athéna-Hélène Stourna, fait référence à deux périodes : entre 1967 et 1974, pendant la dictature, les artistes ayant fui le pays écrivent depuis l’étranger les premières pièces documentaires, profitant d’une certaine liberté d’expression. Ce fut le cas de Giorgos Skourtis et Vassilis Vassilikos. Un second mouvement, plus récent et lié à la crise économique, politique et sociale qui a débuté en 2010, donne un second souffle aux théâtres documentaires. Ces deux périodes tendent vers le même processus : la recherche de vérité, même si la production de pièces sur ce sujet reste épisodique.
Le tour du monde des Théâtres Documentaires se poursuit, hors Europe et comme le formule Peter Sellars, metteur en scène américain : « Le théâtre aujourd’hui peut être un moyen d’information alternatif. » Aux États-Unis, le travail d’Anna Deavere Smith, performeuse et sa compagnie Tectonic Theater Project, est relaté dans un article de Marie Pecorari qui montre le recul du didactisme et l’évolution des méthodologies au profit des Living Newspapers, ainsi que la manière dont le mot factuel s’est substitué au mot documentaire ; au Brésil, avec la Companhia de Teatro Documentário de São Paulo, dont le propos est de « documenter » dans le sens de « construire un point de vue » à partir de la réalité enregistrée, expérience d’un projet de théâtre documentaire, relatée par Marcelo Soler ; en Colombie avec deux troupes emblématiques du théâtre documentaire : el Teatro Varasanta qui, avec le spectacle Kilele, travaille sur la remémoration du massacre de Bojayá et sur la question de la réparation – plus de cent vingt personnes prises au piège d’une petite église du village, dans la province du Choco, située à l’ouest du pays le long du Pacifique, où un groupe de paramilitaires avait fait exploser des bonbonnes de gaz -. Le second, el Mapa Teatro, compagnie fondée en 1984 à Paris par Heidi et Rolf Abderhalden qui ont inventé un langage commun nommé le laboratoire de l’imaginaire. Deux de leurs spectacles sont présentés dans l’article de Bruno Tackels : Los Santos inocentes et Testigo de las ruinas. Un aperçu du théâtre post-colonial dans son rapport au théâtre documentaire, signé de Bérénice Hamidi-Kim, montre, en repartant de Brecht, l’ambivalence entre projets scientifique et politique. Elle déclare, à travers l’historien italien Carlo Ginzburg, qu’on peut « analyser le théâtre documentaire post-colonial comme une œuvre d’histoire, si l’on entend par histoire, un objet à la frontière du scientifique et du rhétorique. » Elle évoque Rwanda 94, mis en scène par Jacques Delcuvellerie et le Groupov basé à Liège, qui, après un long travail d’enquête, évoque le massacre des Tutsis. Elle parle de colonisation langagière et culturelle, d’esclavage et des rapports Nord-Sud, dans deux spectacles « tournés vers le passé, le présent et le futur » : Vive la France et Bloody Niggers de Dorcy Rugamba, montés par Mohamed Rouahbi, où elle pose la problématique de la citation : on trouve en effet dans ces spectacle les discours de politiques, penseurs et écrivains, dont Franz Fanon et Aimé Césaire, qui transforment la scène théâtrale en scène publique.
Le quatrième volet de l’ouvrage – qui en compte cinq – s’intitule A la recherche de formes et dessine un grand panorama des expériences théâtrales aujourd’hui. Rita Freda décortique la démarche de la co-auteure et metteure en scène Nalini Menamkar, qui présentait en 2012 à la Comédie de Genève Olga, un regard, sous-titré – Essai de théâtre document : L’Histoire, les images et leur critique à l’épreuve de la scène. Il s’agit du portrait d’une femme qui fut pionnière dans les recherches sur la mémoire concentrationnaire et qui apporta son conseil et expertise à Alain Resnais, pour son film Nuit et Brouillard. Béatrice Picon-Vallin présente les méthodes de travail du Théâtre du Soleil, « laboratoire d’une écriture scénique documentaire » développées dans plusieurs de ses spectacles : Le Dernier Caravansérail, dont il existe aussi une version filmée, à partir des récits de vie des réfugiés de Sangatte ; L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, spectacle basé sur des entretiens réalisés au Cambodge dans les camps de réfugiés ; L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves où elle parle de la complexité du transfert de langues. Elle observe les diverses façons dont Le Théâtre du Soleil a capté les récits de vie et travaillé sur la documentation – articles de presse, albums photographiques des grands voyageurs, films documentaires ou de fiction, extraits sonores, documents, parfois personnels, réunis par les acteurs en fonction de leurs origines, improvisations. Hélène Cixous, auteure et proche collaboratrice d’Ariane Mnouchkine, et la directrice du Soleil se sont souvent posées la question, récurrente, de la légitimité de l’appropriation de la parole d’un autre, pour des spectacles qui, partant de l’oralité, sont recréés à l’écrit. Déplacé de son contexte, le document peut parfois mentir.
 Rimini Protokoll, collectif allemand de mise en scène, travaille sur des variations radicales de styles, d’un projet à l’autre. Eliane Beaufils, qui signe l’article, l’intitule Les Laboratoires socio-théâtraux, entre témoignage de soi et Making of. Le collectif a acquis une renommée internationale avec son spectacle Cargo Sofia-X où l’équipe reçoit les spectateurs dans un camion aménagé avec vitre et écran et avec des conducteurs-acteurs qui commentent le trajet et racontent leur vie. Il a aussi présenté Breaking News montrant les coulisses de la production des journaux télévisés ; Black Tie qui invite à réfléchir sur l’identité, à partir d’une enquête sur l’adoption ; 50 Aktenkilometer Berlin, un parcours audioguidé où l’équipe propose un itinéraire dans Berlin, sur les pas de la Stasi. L’authenticité devient la clé de lecture du public dans une perception modifiée du réel, à travers une forme singulière où les acteurs deviennent des « experts du quotidien ». Un autre collectif, nommé Berlin – mais qui travaille à Anvers – est présenté par Aude Clément qui parle des deux cycles montrés aux publics : le cycle Holocène # (de 1 à 4), esquisse le portrait de différentes villes – Jérusalem, Iqaluit sur le territoire Inuit, Bonanza ancienne ville minière du Colorado et Moscow -. Le cycle Horror Vacui # (de 1 à 3) construit des spectacles autour de micro-situations et de faits divers. Le premier, Tagfish, est une réflexion sur la ré-interprétation des friches industrielles. Les spectacles s’inscrivent dans la transdisciplinarité, avec écrans, installations vidéo, univers technologique visuel, et, parfois, avec des comédiens et des musiciens. Le travail de Walid Raad, enseignant et artiste libano-américain est ensuite présenté par Simon Hagemann qui montre l’hybridation à partir du théâtre et des arts visuels – photographie, vidéo, performance, installation -. L’artiste aime à brouiller les discours et met à l’épreuve le réel et la fiction, l’art et le réel, « des pistes prometteuses, dit l’auteur de l’article, pour le théâtre documentaire contemporain ». Le travail de Milo Rau, sociologue, auteur, metteur en scène et réalisateur suisse, évoqué par Erica Magris, ferme cette quatrième partie du livre. Au concept de théâtre documentaire qu’il trouve limité, Milo Rau préfère celui de théâtre du réel. Les projets du metteur en scène, reconnu internationalement, puisent dans l’actualité, ou dans le passé proche : le génocide rwandais pour Hate Radio présenté en 2011 ; la radicalisation djihadiste dans The Civil Wars, en 2015 ; et, la même année, The Congo Tribunal où il met en lumière la guerre au Congo. Installation, films, ouvrages et actions sont la base de son travail, ainsi que l’adresse au public. Il utilise la reconstitution, à l’identique, et en temps réel – appelée reenactment -.
Rimini Protokoll, collectif allemand de mise en scène, travaille sur des variations radicales de styles, d’un projet à l’autre. Eliane Beaufils, qui signe l’article, l’intitule Les Laboratoires socio-théâtraux, entre témoignage de soi et Making of. Le collectif a acquis une renommée internationale avec son spectacle Cargo Sofia-X où l’équipe reçoit les spectateurs dans un camion aménagé avec vitre et écran et avec des conducteurs-acteurs qui commentent le trajet et racontent leur vie. Il a aussi présenté Breaking News montrant les coulisses de la production des journaux télévisés ; Black Tie qui invite à réfléchir sur l’identité, à partir d’une enquête sur l’adoption ; 50 Aktenkilometer Berlin, un parcours audioguidé où l’équipe propose un itinéraire dans Berlin, sur les pas de la Stasi. L’authenticité devient la clé de lecture du public dans une perception modifiée du réel, à travers une forme singulière où les acteurs deviennent des « experts du quotidien ». Un autre collectif, nommé Berlin – mais qui travaille à Anvers – est présenté par Aude Clément qui parle des deux cycles montrés aux publics : le cycle Holocène # (de 1 à 4), esquisse le portrait de différentes villes – Jérusalem, Iqaluit sur le territoire Inuit, Bonanza ancienne ville minière du Colorado et Moscow -. Le cycle Horror Vacui # (de 1 à 3) construit des spectacles autour de micro-situations et de faits divers. Le premier, Tagfish, est une réflexion sur la ré-interprétation des friches industrielles. Les spectacles s’inscrivent dans la transdisciplinarité, avec écrans, installations vidéo, univers technologique visuel, et, parfois, avec des comédiens et des musiciens. Le travail de Walid Raad, enseignant et artiste libano-américain est ensuite présenté par Simon Hagemann qui montre l’hybridation à partir du théâtre et des arts visuels – photographie, vidéo, performance, installation -. L’artiste aime à brouiller les discours et met à l’épreuve le réel et la fiction, l’art et le réel, « des pistes prometteuses, dit l’auteur de l’article, pour le théâtre documentaire contemporain ». Le travail de Milo Rau, sociologue, auteur, metteur en scène et réalisateur suisse, évoqué par Erica Magris, ferme cette quatrième partie du livre. Au concept de théâtre documentaire qu’il trouve limité, Milo Rau préfère celui de théâtre du réel. Les projets du metteur en scène, reconnu internationalement, puisent dans l’actualité, ou dans le passé proche : le génocide rwandais pour Hate Radio présenté en 2011 ; la radicalisation djihadiste dans The Civil Wars, en 2015 ; et, la même année, The Congo Tribunal où il met en lumière la guerre au Congo. Installation, films, ouvrages et actions sont la base de son travail, ainsi que l’adresse au public. Il utilise la reconstitution, à l’identique, et en temps réel – appelée reenactment -.
La dernière partie de l’ouvrage intitulée Oralité et performance documentaires, témoigne de différentes formes de spectacles, relativement inclassables. Carol Martin parle des objets scéniques dans le théâtre, avec le spectacle The Agony and the Ecstasy of Steve Jobs du dramaturge et comédien américain Mike Daisey. Erica Magris présente Ten Billions, spectacle-conférence de Stephen Emmott et Katie Mitchell qui travaillent à la frontière de l’objectivité, de la science et de la subjectivité. Clarisse Bardiot note l’émergence de la conférence-performance, présentée principalement dans les musées et les centres d’art contemporain, c’est-à-dire hors des scènes. Béatrice Picon-Vallin présente La Belleza e l’Inferno un récit fragmenté de et avec Roberto Saviano écrit à partir d’articles, parus entre 2004 et 2009, « un spectacle de type documentaire qu’on pourrait qualifier de limite ». Puis elle analyse le travail de Thierry Bédard et son Association Notoire, qui envisage le théâtre comme un lieu d’exercices. Deux de ses spectacles sont présentés : 47, monté à partir d’un essai de Jean-Pierre Raharimanana « Madagascar 1947 » qui relate un massacre historique dans le pays ; Blow up ! Les guêpes du Panama, une conférence-performance sur les mécanismes d’exclusion présentée en 2001, que le metteur en scène qualifie de forme-conférence, dépouillée de ses références et de ses attributs scientifiques. Sarah Maisonneuve présente une expérience avec assemblage de documents sonores, le spectacle Parlement, de Joris Lacoste, où une actrice seule en scène et face à un micro, énonce des bribes de discours sans liens apparents les uns avec les autres et explore les aspects formels de la parole.
De nombreuses expériences liées de près ou de loin aux théâtres documentaires se développent dans un monde en mutation, en France et dans le monde, Béatrice Picon-Vallin en fait une sorte de recensement en guise de conclusion. La liste est longue et la singularité des expériences, impressionnante, dans une nébuleuse de formes. Des artistes, semblables aux coureur(e)s de fond, inventent et cherchent. Pour exemple et parmi d’autres le Théâtre Majâz, aux identités multiples, abrité un temps sous l’aile du Théâtre du Soleil ou encore le parcours du Théâtre KnAM où depuis plus de trente ans Tatiana Frolova monte des spectacles avec très peu de moyens, dans le petit théâtre qu’elle a créé à Kosmomolsk-sur-Amour, sa ville natale, située dans l’Extrême-Orient de la Russie. Ses créations documentaires racontent son pays à partir de textes, images, entretiens, témoignages, extraits d’articles, études, ouvrages historiques et mémoriels, sa matière première, collectée avec les artistes. Elle a présenté en 2010, Une guerre personnelle, à partir du livre d’Arkadi Babtchenko, récit d’un soldat, qui, à son retour de Tchétchénie, raconte ce qu’il a vu et vécu ; en 2011, Je suis, un travail sur la mémoire et l’oubli ; en 2017, Je n’ai pas encore commencé à vivre, élaboré à partir de témoignages des jeunes de sa ville et d’anciens prisonniers du Goulag. Sans la moindre aide de l’État, Tatiana Frolova poursuit sa route dans une démarche artistique basée sur les témoignages et récits de vie où elle associe différents médias artistiques comme théâtre, musique, vidéo et peinture.
Un siècle après les débuts du théâtre documentaire au sens historique du terme, la frontière entre fiction et réel est devenue plus insaisissable, comme le montrent les articles des contributeurs de l’ouvrage. Force est de constater qu’aujourd’hui les créateurs sont parfois aussi des chercheurs, intégrant le champ des sciences humaines. Ainsi le récent Retour à Reims, d’après un texte de Didier Eribon et Thomas Ostermayer avec la SchauBühne Berlin, qui mêle récit intime et analyse sociologique et qui adapte la version présentée selon le pays dans lequel le spectacle est joué (Allemagne, Royaume-Uni, France, Suisse, Italie). Ou encore Le Procès de Bobigny, spectacle sur l’avancée des droits des femmes à partir de la problématique de l’avortement, dans lequel les deux conceptrices, Émilie Rousset et Maya Boquet, déconstruisent l’aspect théâtral du procès, mené par l’avocate Gisèle Halimi. Les thèmes génériques des spectacles relevant du théâtre documentaire, touchent aux migrants, au nazisme, au conflit israélo-palestinien, aux grands sujets historiques, aux faits de société, au statut des femmes, aux viols. Sur ce dernier thème, Béatrice Picon-Vallin cite le spectacle de la metteure en scène égyptienne Laïla Soliman, Zig Zig, qui traite des viols sous occupation britannique, dans son pays.
Théâtre de résistance, le théâtre documentaire parle du monde d’aujourd’hui et des comportements humains, invente de nouvelles formes de récit, mêle mémoire collective et mémoire individuelle, interroge la barbarie du monde et met la démocratie en question. Il fait entendre la voix des oubliés, invente de nouvelles écritures et matériaux partant d’un petit événement ou d’un grand récit, travaille sur l’hybridation, invente un autre rapport au public à partir de spectacles-commentaires, invitant au débat. Entre théâtre et performance, forme-conférence, mutations du théâtre dit politique, le théâtre documentaire devient une expérience et documente, c’est ce que démontre, tout au long de l’ouvrage, Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin dont le travail de recherche est exemplaire, même s’il ne peut être exhaustif. Elles ouvrent d’importantes fenêtres, à partir du théâtre d’hier sur celui d’aujourd’hui, en fusion, et esquissent les formes scéniques de demain.
Aux trois-quarts de l’ouvrage un cahier d’une trentaine de photographies témoigne de spectacles, et à la fin se trouvent un glossaire et une importante bibliographie sélective. Saluons les éditions Deuxième époque qui permettent la confrontation d’expertises entre les professionnels des arts et du spectacle, et la publication de travaux de référence : ici, de nombreux témoignages dans lesquels se lit en filigrane l’Histoire, depuis le début du XXème jusqu’aux tentatives théâtrales les plus récentes, en France et dans le monde. « Le théâtre est le lieu de la réalité la plus forte. C’est un verre grossissant, un zoom. Le théâtre est plus fort que le réel » conclut Tatiana Frolova.
Brigitte Rémer, le 23 mars 2020
* Contributeurs : Laurence Allard, Clarisse Bardiot, Éliane Beaufils, Jean-Louis Besson, Aude Clément, Rita Freda, Martin Goutte, Simon Hagemann, Bérénice Hamidi-Kim, Stéphanie Loïk, Sarah Maisonneuve, Carole Martin, Kristina Matvienko, Mirella Patureau, Marie Pecorari, Marcelo Soler, Gérald Stieg, Athéna-Hélène Stourna, Bruno Tackels – Ces contributions sont accompagnées de textes de : Marc Bloch, Peter Brook, Jacques Le Goff, Jeanne Lorang, Derek Paget, Erwin Piscator, sur papier grisé, appelé Encadrés.
Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin (dir.), Les Théâtres documentaires – Éditions Deuxième époque, (Montpellier), 2019 – 463 pages (29 euros) – email : contact@deuxiemeepoque.fr

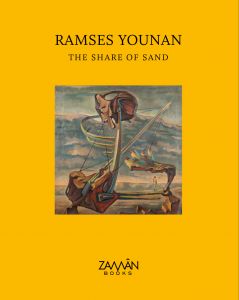 Ouvrage collectif initié par Jozéfa Younan, Sonia et Sylvie Younan, édité par Zamân Books.
Ouvrage collectif initié par Jozéfa Younan, Sonia et Sylvie Younan, édité par Zamân Books.
















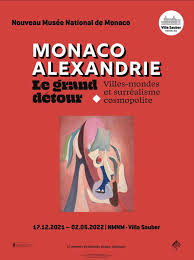
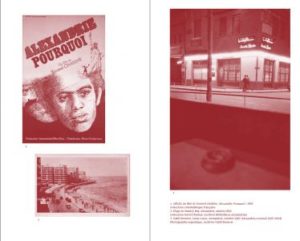




















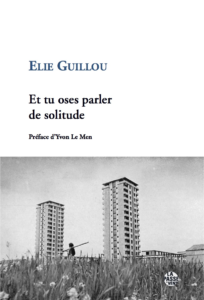



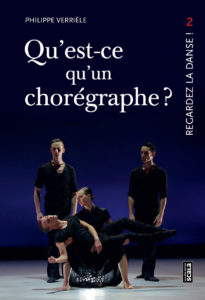




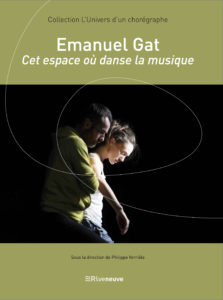

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.