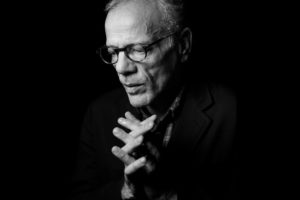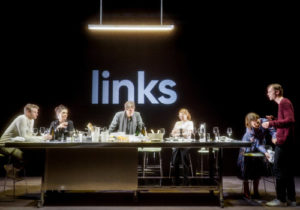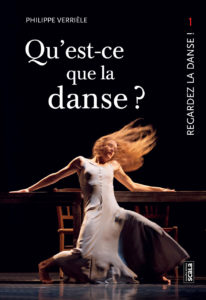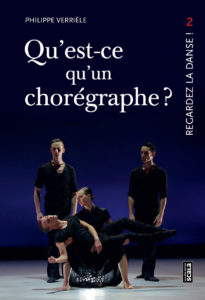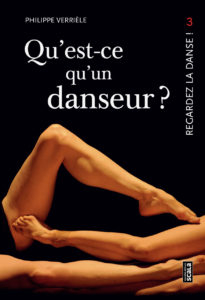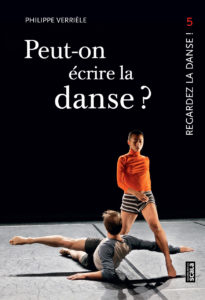« La Loge » pastel sur papier (1885) © Musée d’Orsay
Exposition présentée par le Musée d’Orsay et de l’Orangerie, National Gallery of Art de Washington, l’Opéra de Paris à l’occasion de son trois cent cinquantième anniversaire, et avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque Nationale de France – Commissaire général Henri Loyrette.
De l’Opéra, Edgar Degas capte les coulisses, les salles de répétition, l’entrée et la sortie de scène, le décor et le public, par quelques traits fougueux et parfois imprécis, dans une mêlée des couleurs. Il s’intéresse aux danseuses, aux musiciens de l’orchestre, aux spectateurs. Passionné de musique par son père, Degas prend l’opéra comme source d’inspiration majeure de son travail après avoir acquis un statut lui permettant d’y circuler, des coulisses au foyer. « Il fait très vite de l’Opéra son laboratoire, un endroit où il peut tester librement la question de l’éclairage, la forme et le fond » commente Henri Loyrette, commissaire général de l’exposition. Dans la salle de la rue Le Pelletier qu’il affectionnait particulièrement – salle détruite par un incendie en 1873 – et avant l’inauguration, en 1875, du nouvel Opéra construit par Charles Garnier, il observe, esquisse et expérimente. Il fait aussi longuement poser les jeunes modèles dans son atelier et rapporte avec une grande précision la position des bras, les pliés, la cambrure, la pointe et le cou-de-pied.
Né en 1834 dans une famille de la haute bourgeoisie, à l’origine de Gas, et doué d’un talent de dessinateur remarqué, Edgar Degas commence par fréquenter le Musée du Louvre et le cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale pour copier les œuvres des grands maîtres. Il est admis à l’École des Beaux-Arts de Paris comme élève du peintre Louis Lamothe, élève d’Ingres, avant de séjourner longuement en Italie pour se plonger dans la copie des maîtres de la Renaissance. Après son retour il expose, en 1865 au Salon de peinture et de sculpture, fréquente le café Guerbois, lieu de rencontre des artistes et intellectuels situé dans le quartier des Batignolles qu’il peint en 1868. Il séjourne pendant deux mois sur la côte normande, l’année suivante – à Étretat, Villers-sur-Mer et Boulogne-sur-Mer – où il dessine une série de paysages au pastel. Il participe à l’ensemble des expositions du groupe impressionniste dont la première a lieu en 1874, dans lesquelles il se montre actif. Il y expose, en 1881 sa sculpture la Petite Danseuse de quatorze ans – magnifique bronze fondu à la cire perdue de la taille d’une enfant, avec patine aux diverses colorations, tutu de tulle, ruban de satin rose dans les cheveux, posé sur un haut socle en bois – sculpture présentée dans l’exposition et qui, à l’origine, fit scandale. Plus de cent cinquante modèles en cire ou en terre seront d’ailleurs découverts dans son atelier après sa mort, en 1917. Les Impressionnistes le reconnaissent comme un des leurs même s’il privilégie les scènes d’intérieur, contrairement à eux, pour se protéger du soleil, ayant été sujet, très tôt, à des problèmes de vision. Une scission interviendra plus tard entre eux, en 1894, au moment de l’affaire Dreyfus.
Plus de deux cents oeuvres sont présentées au Musée d’Orsay, huiles, pastels, dessins et monotypes sur différents types de support – dont des éventails – mais aussi sculptures et maquettes de décors. Le parcours élaboré par les commissaires est construit en dix sections. Après une introduction au sujet intitulée « Génétique des mouvements » montrant très tôt l’intérêt de Degas pour le spectacle d’opéra, on plonge au cœur du sujet par la musique. La seconde section intitulée « Le cercle musical » témoigne des portraits de musiciens, d’instruments et d’instrumentistes. Ainsi le tableau Les Musiciens (1872/73) vus de la fosse d’orchestre, vêtus de noir, avec, au loin, la scène et les ballerines, ou celui de L’orchestre de l’Opéra ; des portraits, dont celui en gros plan de la pianiste Marie Dahau, sœur d’un joueur de basson qui avait commandé l’œuvre, et celui de Madame Camus au piano assise de dos, partition ouverte (fusain et crayon noir sur papier vélin, 1869).
« L’Opéra, de la salle Le Pelletier au Palais Garnier » troisième section, montre une imposante maquette de l’Opéra Garnier, réalisée avec force détails pour l’Exposition Universelle de 1900, à Paris. Un mur joliment scénographié met en relief des maquettes de décors : Aïda, l’Opéra de Verdi, datant de 1880 avec l’Acte III « les Rivages du Nil » ; Faust de Gounod dans son Acte IV « Les montagnes du Harz. » Des maquettes de costumes finement dessinées – aquarelle, gouache ou plume – comme celle de La Korrigane, conçue en 1880, pour le ballet de Charles-Marie Widor complètent cette partie.
La quatrième section intitulée « Salle, scène, coulisses » introduit aux premières classes de danse dessinées et peintes par Degas, à partir de 1870 : entraînements à la barre, jetés, ronds de jambe, entrechats et pirouettes, bras arrondis et en suspens. Le regard fouille et le peintre travaille l’art du détail dans des jeux de miroirs. Ainsi, à côté des tutus blancs, des points de couleurs attirent le regard : émeraude, rouge, reflets bleus ou jaune paille, soie orangée, ceintures et rubans, nœuds dans les cheveux, rubans au cou, cheveux roux, chaussons rose pâle. Degas capte les danseuses y compris dans leur intimité et dans l’effort. Le Portrait d’amis sur la scène, portrait de Ludovic Halévy, dramaturge, romancier et librettiste, et celui d’Albert Boulanger-Cavé, inspecteur des spectacles publics, un pastel sur papier de 1879, sème le doute. Degas illustre les nouvelles des Petites Cardinal grand succès d’Halévy qui racontent les aventures galantes de deux danseuses de l’ancien Opéra de la rue Le Pelletier, monotypes en noir et blanc que le peintre définit comme des « dessins faits à l’encre grasse et imprimée. » Il s’invente aussi, quand de besoin, d’autres techniques, par exemple en enlevant l’encre pour créer de nouvelles formes.
La cinquième section : « Sérieux dans un endroit frivole, les abonnés », montre d’inquiétants personnages, messieurs vêtus de noir, chapeau claque, redingote et parapluie, plus ou moins dissimulés dans la coulisse et qui épient leurs protégées, jeunes danseuses principalement issues de milieux pauvres et proies idéales souvent livrées par leurs propres mères. On traverse le côté sombre de cet univers clos l’Opéra, basé sur la séduction et la domination. A deux pas de l’Opéra se trouve d’ailleurs une maison close. Dans Le Rideau, un pastel sur fusain et monotype monté sur carton, réalisé vers 1881, Degas met en scène un rideau décoré d’arbres et de verdure au trois-quarts baissé laissant apercevoir une ligne de jambes et de chaussons. Vu de la salle, les hommes patientent. Dans Deux hommes deux danseuses, pastel sur monotype de 1876/77, le premier couple est assis sur un banc, le second debout, hommes et jeunes femmes se parlent. Examen de danse, pastel sur papier datant de 1880, fait partie de cette série.
La sixième section, « L’Opéra, laboratoire technique », montre à quel point le contexte de l’Opéra a nourri Degas dans ses recherches en termes de supports et formats (éventails, tableaux en long), points de vue (le sujet vu en plongée ou en contreplongée, le sujet décentré), diversité des techniques. Ses tableaux sont soigneusement composés après de nombreuses esquisses jetées sur papier dans de petits carnets, et travaillées. On trouve ainsi dans l’exposition des études comme La danseuse assise tournée vers la droite, une huile et peinture à l’essence sur papier bleu, esquissée vers 1873 ; des monotypes à l’encre noire comme Le Maître de ballet en 1876 ou Au théâtre, vers 1878 ; des négatifs sous verre mettant sur le devant de la scène une Danseuse du corps de ballet (vers 1896). La septième section se compose de formats particuliers sur lesquels Degas aimait à travailler, les « Tableaux en long », en fait, des doubles carrés. Ce format, qui pourrait évoquer une frise, lui permet de privilégier la diagonale. Le thème représente invariablement des danseuses dans une salle de répétition. On a l’impression de suivre une même danseuse dans les temps successifs de sa journée ou de son cours, comme en une sorte de décomposition du mouvement, façon Muybridge, ou comme une bande dessinée. Dans cette série, La Leçon de danse, tableau présenté au Salon impressionniste de 1880 ; Ballet, dit aussi L’Étoile, pastel sur monotype de 1876/77 où l’on voit une ballerine exécutant une arabesque, diadème dans les cheveux, ruban noir au cou, bouquet à la main, avec, en fond de scène à peine esquissées, le corps de ballet dans des volutes de tulle et de décors. Comme souvent, à l’abri d’un rideau, un homme à peine suggéré, observe. On voit aussi une ballerine penchée, ajustant son chausson, sa ceinture bleue attirant le regard, et une scène où Arlequin est aux pieds de la danseuse dans un décor rococo avec l’huile sur bois datant de 1895, Arlequin et Colombine.
Le thème de la huitième section traite des « Éclairages et points de vue ». Degas travaille l’incidence de la lumière sur les corps et sculpte le réel. Les lustres fastueux de l’Opéra sont mis en valeur, au moment où, au milieu du XIXe, apparaît l’arc électrique après que le gaz ait remplacé la bougie. Sont présentées dans cette section L’Opéra/Danseuses à la barre, dans l’ancien Opéra Le Pelletier (1877) pastel sur monotype dessiné depuis la scène, où les pointes en ligne des danseuses en tutus sont dans le même champ de vision que les premières rangées des spectateurs, et à peine suggérée par un indice noir, une épaule évoque la présence d’un homme aux aguets ; Étude de loge au théâtre, pastel sur papier de 1885, met en relief le visage penché vers la scène d’une spectatrice en surplomb qui se confond avec la statuaire de l’ornementation de la salle ; La Loge, montre des danseuses en mouvements et en couleurs, dans une atmosphère détendue.
Dans la neuvième section de l’exposition sont présentés les « Grands dessins synthétiques » d’Edgar Degas. A partir de 1886, après la dernière exposition des Impressionnistes, l’artiste se concentre sur le dessin au fusain, réalisé sur de grands formats, pour mieux capter le rythme du corps et des mouvements. « Une fois que je tiens une ligne, je la tiens, je ne la lâche plus » dit-il. Ainsi les Trois études d’une danseuse (1895/1900) ou la Danseuse assise (1873/74) graphite et fusain, avec rehauts de blanc sur papier rose mis au carreau ; Deux études de danseuses, l’une à la verticale, de face, en arabesque, l’autre à l’horizontale, de dos et réglant sa ceinture (vers 1873), pierre noire rehaussée de craie blanche sur papier vert. Toujours à la recherche de la perfection, Degas fait des esquisses, gros plans sur les pieds et les figures de danse. Dans la dernière section dite « Orgies de couleurs » les tutus blancs ressortent sur des fonds de couleurs soutenues et profondes. Ainsi les Danseuses bleues, huile sur toile de 1893/95 ; Trois danseuses en jupes saumon, pastel sur papier marouflé sur carton de 1904/1906 ; Deux danseuses au repos se détachant sur un fond jaune vif, pastel sur papier vélin fin, exécuté vers 1910 ; ou encore la Danseuse aux bouquets, huile sur toile, vers 1895/1900, où la ballerine au tutu violine, grand décolleté et fleurs dans les cheveux, reçoit des applaudissements, bouquets rouges entourés de papier blanc à ses pieds, avec en arrière-plan, un décor montagneux à la verdure abondante sous clarté diaphane.
Cette riche exposition, Degas à l’Opéra – présentée par le Musée d’Orsay et fruit d’un important travail, retrace l’histoire des petits rats, ces toutes jeunes filles de huit à seize ans que les mères poussaient parfois avec cruauté dans l’ascenseur social – a valeur documentaire. Issu du mouvement réaliste, avant d’être rattaché au courant impressionniste, Degas est au cœur des changements culturels de son époque qu’il observe finement, dessine, peint et sculpte avec beaucoup de relief et d’insolite, l’Opéra pour laboratoire. « Il faut avoir une haute idée non pas de ce qu’on fait « mais de ce qu’on pourra faire un jour » : sans quoi ne n’est pas la peine de travailler » écrivait-il.
Brigitte Rémer, le 5 octobre 2019
Commissaire général Henri Loyrette – Commissaires : Leïla Jarbouai, conservatrice arts graphiques au musée d’Orsay – Marine Kisiel, conservatrice peintures au musée d’Orsay – Kimberly Jones, conservatrice des peintures françaises du XIXe siècle à la National Gallery of Art de Washington – Autour de l’exposition, de nombreuses activités sont proposées telles que concerts, conférences, performance et spectacles (dont les 11 et 12 octobre un parcours spectacle, création de l’Opéra de Paris, sous la direction d’Aurélie Dupont, directrice de la danse à l’Opéra national de Paris et Nicolas Paul, chorégraphe).
Du 24 septembre 2019 au 19 janvier 2020, au Musée d’Orsay, grand espace d’exposition, 1 rue de la Légion d’Honneur. 75007 – métro : Solférino – site : www.musee-orsay.fr – tél. : 01 40 49 48 14. L’exposition sera ensuite présentée du 1er mars au 5 juillet 2020, à National Gallery of Art de Washington (États-Unis). Catalogue coédité par le Musée d’Orsay et la RMN (45 euros).