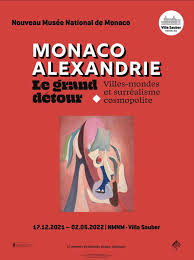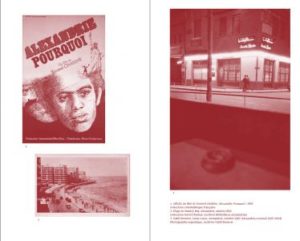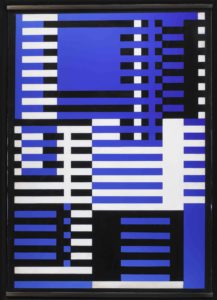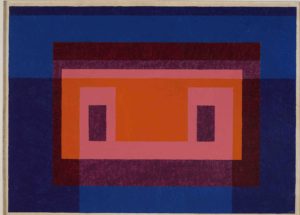© Éditions du Seuil
De la préhistoire à nos jours. Sous la direction de Laura Cappelle – Avant-propos de William Forsythe – Éditions du Seuil – Avec le concours du Centre National de la Danse.
Plus de vingt-cinq contributeurs internationaux, historiens, experts issus des sciences sociales, de de la danse et du théâtre sont réunis autour de Laura Cappelle, sociologue et journaliste, pour apporter leur vision de spécialistes de la danse à cette « Nouvelle histoire de la danse en Occident ». Ils font le point des connaissances, qu’ils analysent, chacun selon son champ de recherche, rendent compte de la complexité de ce « langage non verbal qu’est la danse » et de la porosité d’un art qui se développe bien au-delà des frontières de l’Occident, des États-Unis et de la Russie dont traite principalement l’ouvrage.
Quatre parties fondent ce parcours qui va « De la préhistoire à nos jours », sous-titre de la recherche : la première, intitulée Danse sacrée, Danse profane, de la Préhistoire au Moyen-Âge interroge les apports de l’archéologue et de l’anthropologue sur la représentation de figures dansantes, plus de quarante mille ans avant notre ère. Yosef Garfinkel, professeur en archéologie, observe, par les gravures, les rites de passage où « la danse sort de la séduction individuelle pour être pratiquée à un niveau collectif », où la pratique de danses sociales – danses en cercle, en ligne et de couple – est visible, où la danse humaine apparaît sous forme de transe, enseignée par le chaman et « permet d’établir un contact direct avec le surnaturel. » Ce premier chapitre entraîne ensuite le lecteur En Grèce, une culture citoyenne de la danse au pays de Platon, qui déclare : « Ce qui est beau élève l’âme. » On y trouve l’évocation des danses guerrières et pacifiques et celles pratiquées lors des fêtes religieuses ; le rappel des grands dramaturges comme Eschyle, Sophocle, Euripide et Aristophane dont une grande partie des œuvres incluait la danse, avec son caractère mimétique qui, peu à peu, évolue vers la pantomime ; les danses apollinienne et dionysiaque « distinction esthétique réalisée par Nietzsche » liées au culte d’Apollon et de Dionysos cohabitant à Delphes, figures centrales dans la danse grecque. « Les sources laissent entrevoir la place importante que pouvait avoir la danse dans l’apprentissage comme dans l’expression de la citoyenneté » conclut Marie-Hélène Delavaud-Roux, spécialiste en histoire ancienne. Rome, entre passion et condamnation, Rome dont les sources sont plus rares et dont le seul Traité sur la danse, datant du 1er siècle avant JC. a disparu, montre l’intérêt de l’ensemble de la classe sociale romaine pour la danse, malgré certains clivages. Marie-Hélène Garelli, professeure en langue et littérature latines montre la manière dont la danse participe de la construction de l’image du citoyen sous Philippe Auguste, par les danses guerrières pratiquées par les soldats, les rituels de certaines confréries religieuses et l’invention par Pylade de la pantomime, véritable innovation esthétique. On ne retrouve pas de chœurs écrits dans les textes dramatiques latins.

© Éditions du Seuil
L’auteur du dernier volet de cette première partie, Adrien Belgrano, doctorant en histoire médiévale et agrégé d’histoire, rappelle par son article, De l’ordre cosmique au rituel diabolique : l’église et la danse au Moyen-Âge, que lors du haut Moyen-Âge (Vème au XIème siècle) les chrétiens dansaient dans et même hors du cadre liturgique et que les premiers conciles n’ont pas interdit, mais régulé, les pratiques. La censure est venue avec le concile de 692 interdisant une série de danses assimilées à des pratiques païennes. A partir du XIIème siècle, la danse est devenue loisir aristocratique au même titre que le tournoi et la chasse. Aux XIVème et XVème siècle elle est manifestation allégorique, pour exemple la danse macabre. Cette période, par la liturgie chrétienne, garde une méfiance par rapport au corps, source de péché.
La seconde partie de ce puissant ouvrage sur la «Nouvelle histoire de la danse en Occident » s’intitule « Vers l’épanouissement de la danse scénique. De la Renaissance au XIXe siècle. » Marina Nordera, danseuse et historienne de la danse parle de La naissance du Ballet, un phénomène culturel européen. La définition du mot « ballet » issu de l’italien, se réfère au bal et aux formes chorégraphiques qu’on y exécute. Le ballet de cour à la fin du XVème siècle, le ballet à la Cour de France où le souverain occupe la place centrale, les diverses formes chorégraphiques qui alternent comme danses de couple, figures dessinées sur scène, marches rythmées ou formes processionnelles. Au XVème et XVIIème siècle, la circulation des artistes en Europe, puis des maîtres à danser dans les maisons nobles se met en place.

© Éditions du Seuil
Les XVIIème et XVIIIème siècles, A la recherche de corps éloquents sont traités par Marie Glon, chercheuse sur l’histoire et l’actualité de la danse. Elle indique que « Danser est considéré comme une activité où s’exerce l’éloquence » et que cela façonne « un art de se comporter et de se mouvoir dans toutes les situations de la vie. » C’est en 1700 qu’apparaît le mot chorégraphie et le maître de danse tient la même place que le musicien ou le ménétrier. Si les danses à deux restent emblématiques de l’époque, les danses collectives comme courante, menuet, contredanse etc. se développent aussi. Dans Le corps en révolution l’historienne Elizabeth Claire évoque l’enthousiasme républicain, après la Révolution, et une nouvelle culture de loisirs nocturnes qui envahit Paris, dont la danse de société, la danse en couple (la valse, entre autres), le retour des bals publics à compter de 1800. On parle de « dansomanie » et de fraternité retrouvée. L’avènement du ballet romantique, présenté par Sylvie Jacq-Mioche, docteure en esthétique et historienne du ballet montre Paris comme pivot européen du monde chorégraphique, évoque l’influence des théâtres de boulevard sur l’évolution du ballet et le rôle de l’Opéra de Paris. Pour la première fois, en 1827, Marie Taglioni y apporte la technique des pointes ce nouvel idéal esthétique, elle y danse La Sylphide, ballet phare et Giselle, dans le plus pur romantisme. Erik Aschengreen, docteur en lettres, professeur émérite en histoire et esthétique de la danse à Copenhague présente August Bournonville, un romantisme danois. Il est une importante figure de la danse danoise, très critique à l’égard du ballet français, promoteur d’un style bien particulier basé sur la joie de vivre et la grâce, et il possède un répertoire personnel d’une grande ampleur.
Dans cette traversée du temps, on arrive à la seconde moitié du XIXème siècle jusqu’à Marius Petipa, une carrière qui façonne le Ballet Impérial Russe. Sergey Konaev, chercheur principal en danse à l’Institut national des Arts de Moscou en trace le parcours. Chorégraphe français, parti à Saint-Pétersbourg en 1847, Petipa y fait une éblouissante carrière, non sans embûches, tout en partant conquérir les capitales européennes avec son épouse, Maria Sourovchtchikova-Petipa. Soutenu par le directeur des Théâtres impériaux, Ivan Vsevolozhsky, c’est aussi le moment où il travaille sur les pièces des plus importants compositeurs de l’époque, Tchaïkovski entre autres, dont il chorégraphie La Belle au bois dormant, Le Lac des cygnes et Casse-Noisette ; il crée également la chorégraphie de Raymonda, de Glazounov, et obtient la nationalité russe en 1894. Le Miroir magique, créé en 1903 sur une musique d’Arseni Korerchtchenko d’après un poème de Pouchkine, sera son dernier ballet, il meurt quelques années plus tard. Le chorégraphe laisse de nombreuses archives, les siennes propres et les notations chorégraphiques de ses œuvres réalisées par d’autres, notamment celles de Vladimir Stepanov, danseur du corps de ballet à Saint-Pétersbourg, qui a inventé un système de notation de la danse. En écho à cet article, Alastair Macaulay, critique de danse et spécialiste américain des arts de la scène, développe le style chorégraphique de Marius Petipa en livrant le fruit de ses recherches avec Retrouver le classicisme de Petipa, qualifiant le chorégraphe de « maître joaillier » et soulignant son influence sur les générations de chorégraphes qui suivent. Danseuse et chorégraphe, professeure à l’Université Paris VIII, Hélène Marquié revient En France à la fin du XIXème siècle, effervescence et expérimentations, mettant l’accent sur la remise en question de l’historiographie au regard des récits sur la danse de cette époque : décadence du ballet français autour de l’Opéra de Paris en même temps que nouvelles voies tracées par les Ballets Russes de Serge Diaghilev et formes modernes apportées par Isadora Duncan. Des assouplissements législatifs envers les institutions théâtrales, entre 1860 et 1870, leur permettent l’utilisation de décors et costumes et la présentation de spectacles de différentes natures. Ainsi la danse va-t-elle prendre possession des théâtres, des cafés-concerts et des music-halls. Mariquita par exemple, célèbre maitresse de ballet de la Belle-Époque se produira aux Bouffes-Parisiens, puis au Théâtre de la Porte Saint-Martin et aux Folies-Bergère. La vitalité vient, pour une bonne part, des milieux populaires, les exotismes de tous bords s’apprécient, les femmes s’inscrivent comme leaders et premières féministes sans le savoir, elles sont à la pointe de ces mouvements rénovateurs.
La troisième partie de l’ouvrage mène le lecteur au XXème siècle face à la modernité. Adeline Chevrier-Boisseau, maîtresse de conférences en études américaines et en études de danse à l’Université Clermont-Auvergne observe A l’aube de la modernité : Loïe Fuller, Isadora Duncan et souligne l’importance des échanges transatlantiques. Pourtant, le climat puritain américain de la fin du XIXème participe de la dévaluation des femmes, a fortiori des femmes artistes, jusqu’à ce qu’elles se rebellent, faisant émerger une féminité nouvelle. Un nouveau rapport au corps voit le jour, selon les travaux de François Delsarte ; le musicien Emile Jacques-Dalcroze élabore une méthode d’apprentissage qui a d’importantes répercussions sur les innovations chorégraphiques. C’est dans ce contexte que Loïe Fuller, élevée dans une banlieue de Chicago, arrivant en France en 1892 sans formation en danse, construit sa danse serpentine. Elle s’investit dans tous les aspects techniques de ses chorégraphies, crée un style chorégraphique subversif qui peut être considéré aujourd’hui comme queer. Née à San Francisco et formée à la danse, l’idéaliste Isadora Duncan quant à elle participe de la libération du corps, développe une danse intuitive, cherche la pureté du mouvement et met en place une autre philosophie de l’enseignement. Viennent ensuite Les Ballets Russes, un creuset artistique racontés par Sarah Woodcock, spécialiste de la danse, ancienne responsable des collections de photographies et de costumes au Victoria and Albert Museum de Londres. Première compagnie commerciale indépendante créée en 1907 par Serge de Diaghilev, ni compositeur ni chorégraphe, les Ballets Russes se développent sous la supervision de leur fondateur éclairé, doué pour déceler les talents et positionner la troupe à l’avant-garde chorégraphique. Michel Fokine, premier danseur et maître de ballet au Ballet Impérial de Saint-Pétersbourg rallie la compagnie et tient une place importante dans son évolution. Anna Pavlova incarne la ballerine par excellence et crée la mythique Mort du cygne en 1905. En 1909, les Ballets Russes sont à Paris présentant quatre ballets en un acte de Fokine, le succès est immédiat. Vaslav Nijinski fait partie de la tournée qui, au-delà de la France, sera aussi européenne. Renvoyé des Théâtres impériaux en 1911, le danseur sera intégré aux Ballets Russes, jusqu’à ce que la schizophrénie le rattrape, en 1916 et qu’il soit interné. Sa sœur, Bronislava Nijinska, sera l’une des premières femmes à obtenir une reconnaissance en tant que chorégraphe. Léonide Massine, soliste charismatique, succède à Nijinski. Pendant la première guerre mondiale les Ballets Russes sont dispersés un peu partout dans le monde, Diaghilev vit en Suisse, la Révolution d’octobre 1917 l’ayant définitivement coupé de son pays. En 1924, Georges Balanchine intègre la troupe. A la mort de Diaghilev, en 1929, les dettes s’étant accumulées, les Ballets Russes se dispersent. De nouvelles compagnies se formeront et feront vivre les chorégraphies de Fokine, Nijinski et Massine.
D’un pays à l’autre, Laure Guilbert, enseignante en histoire et en théorie des arts du spectacle dans plusieurs universités de France et d’Allemagne, chercheuse indépendante, mène ensuite le lecteur sur les chemins De l’expressionnisme allemand au Tanztheater à partir d’une sorte d’âge d’or artistique de la Mitteleuropa, entre les deux guerres. La danse a acquis ses lettres de noblesse comme art, la place du corps est devenue centrale, son expressivité se décline dans différentes directions comme la gymnastique rythmique, la kinésphère etc. De nombreuses personnalités participent de ces initiatives et recherches artistiques, chacune dans sa discipline : Adolphe Appia pour la scénographie, Rudolf Steiner dans la réflexion anthropologique autour de l’eurythmie, le groupe Cavalier bleu en peinture, le dessinateur et danseur hongrois, Rudolf von Laban qui crée un nouveau système d’écriture de la danse. Mary Wigman développe l’improvisation et la composition et s’intéresse aux arts extra-européens. De nombreuses écoles privées s’ouvrent notamment à Berlin et la danse se professionnalise. Cette euphorie artistique se suspend avec le krach financier de 1929 puis, quatre ans plus tard, avec la prise de pouvoir d’Hitler. Le milieu chorégraphique se disperse dès 1933. En 1945 la reprise sera difficile, d’autant avec la construction du rideau de fer qui sépare les artistes des deux Allemagne. Mary Wigman crée Le Sacre du Printemps en 1957, à Berlin Ouest où elle est installée. Un nouveau code artistique émerge avec « l’esthétique de l’incorrect » du Tanztheater, concept de danse-théâtre conçu dès 1928 par Kurt Joos, danseur, chorégraphe et célèbre pédagogue dont Pina Bausch fut l’élève. Marcia B. Siegel, enseignante et critique de danse aux États-Unis, auteure de nombreux ouvrages sur la danse plonge ensuite le lecteur dans Une série d’avant-gardes : la danse moderne et postmoderne américaine. Elle présente la danse expérimentale aux États-Unis, la fin de la modern dance et l’émergence de la post-modern dance, qui perd ensuite son trait d’union et devient la postmodern dance, forme qui, au point de départ, a peu d’appuis institutionnels. La liste est longue des danseuses/danseurs et chorégraphes cité(e)s par la contributrice, qui laissent leur empreinte au cours de ces années-là : Martha Graham, Merce Cunningham, José Limón, Alwin Nikolaïs, Alvin Ailey, Paul Taylor et tant d’autres. Certaines étaient venues plus avant dans le temps, comme Isadora Duncan (1877/1927) ou Ruth Saint-Denis (1879/1968) qui en avaient tracé les prémices par leurs propres recherches. D’autres viennent plus tard, au cours des années 1970 notamment le Judson Dance Theater avec Rainer, Steve Paxton et David Gordon, puis Trisha Brown, Lucinda Childs, Meredith Monk, suivis de Jerome Robbins et Twyla Tharp qui font la synthèse chorégraphique entre les techniques classique et moderne. « À la fin des années 2000, déjà, la modern dance est en pratique devenue un genre hybride, sans désignation claire » conclut la contributrice.

© Éditions du Seuil
Du bal à l’écran : la danse à l’âge des médias de masse, l’article signé de Aude Thuries, docteure en danse de l’Université de Lille et enseignante en culture chorégraphique passe en revue différentes formes dansées et évoque leur diffusion à l’écran, notamment à la télévision : les productions de Broadway et l’âge d’or du musical hollywoodien, la musique et la danse afro-américaine, la modern jazz, les comédies musicales égyptiennes de la première partie du XXème siècle qui font la part belle à la danse, l’industrie cinématographique indienne qui séduit avec Bollywood, le voguing qui s’est essentiellement développé dans les années 1970 dans la communauté gay afro-américaine, les films de danse à partir des années 1980. Un grand chapitre intitulé Extension du domaine du ballet : les ambitions néoclassiques, rassemble cinq contributions : Georges Balanchine ou l’académisme renouvelé par Tim Scholl, chercheur spécialiste de la danse russe et américaine, qui présente l’esthétique de Balanchine et du New-York City Ballet. Ce même auteur signe aussi l’article sur Le ballet soviétique : retour vers le futur où l’on refait le parcours, à compter du début du XXème siècle. Geraldine Morris, ancienne danseuse du Royal Ballet, aujourd’hui chercheuse en danse, présente un article intitulé Au Royaume-Uni et en Allemagne, une nouvelle lignée chorégraphique, dessinant le profil de deux chorégraphes anglaises issues des Ballets Russes et fondatrices de deux importantes compagnies : Ninette de Valois pour le Royal Ballet et Marie Rambert pour le Ballet Club devenu le Ballet Rambert. Parlant ensuite des « influences britanniques en Allemagne de l’Ouest » elle évoque entre autres le parcours et l’influence de John Cranko, danseur et chorégraphe né en Afrique du Sud qui, après avoir intégré le Royal Ballet de 1947 à 1957 avait rallié le Ballet de Stuttgart et l’avait profondément transformé. Florence Poudru, historienne, professeure au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, traite Le néoclassicisme en France, de l’évocation au corps à corps, et observe les trois décennies qui suivent la Libération, avec les jeunes danseurs chorégraphes qui développent leurs projets artistiques en dehors des théâtres subventionnés, comme Jeanine Charrat, Roland Petit, Ludmilla Tcherina, Maurice Béjart etc. Gerald Siegmund, professeur en études théâtrales à la Justus-Liebig Universität, Giessen, en Allemagne, parle de Deux novateurs de la fin du XXème siècle : Jiří Kylián et William Forsythe, du style néoclassique singulier du premier, directeur pendant trente ans du Nederlands Dans Theater ; du second, William Forsythe, engagé par le Ballet de Stuttgart en 1973 avant de diriger de 1984 à 2004 le Ballet de Francfort, puis de travailler en indépendant avec The Forsythe Company. Actuellement chorégraphe associé au ballet de l’Opéra de Paris, il poursuit sa recherche de théâtralité par l’introduction des arts visuels dans ses créations et le processus de déconstruction du ballet classique, même s’il garde une approche néoclassique. Pauline Bolvineau, maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université catholique de l’Ouest conclut cette partie en s’interrogeant sur le concept d’Être « contemporain » en Europe, à partir du processus de libération du corps qui s’est mis en marche dans les années 1970.
La quatrième et dernière partie de cette Nouvelle histoire de la danse en Occident : Recompositions chorégraphiques. De la fin du XXème au début du XXIème siècle présente, avec Felicia Mc Carren, professeure d’études françaises à Tulane University (États-Unis), spécialiste de l’histoire culturelle de la danse, Le hip hop, de la rue à la scène. Né dans le Bronx, à New-York, le hip hop mêle aujourd’hui à son vocabulaire celui de la danse contemporaine. Il a acquis une légitimité sur les scènes et dans le milieu artistique avec son passage de statut d’amateur à celui de professionnel, à la fin des années 80. Aux États-Unis, Rennie Harris établit le lien entre culture populaire et théâtre, en France, Kader Attou et Mourad Merzouki, formés à la boxe, aux arts martiaux et à la gymnastique fondent, avec Lionel Frédoc et Eric Mezino, Accrorap, en 1989 date à partir de laquelle ils sont reconnus et programmés dans le réseau des scènes nationales. Laura Cappelle, sociologue et journaliste, critique de danse pour le Financial Times et pour le New-York Times, qui a dirigé cet ouvrage, invite ensuite à une réflexion sur le fait d’Être classique au XXIème siècle, une identité paradoxale. Elle suit les transformations de la danse classique au début de ce siècle et l’organisation du secteur de la danse, en observant les troupes résidant dans les maisons d’opéra, les compagnies indépendantes et les coproductions obligées compte tenu de la baisse des subventions. Elle rend compte de la nouvelle répartition des rôles à la tête des institutions de la danse ; de la recherche d’équilibre entre femmes et hommes aux postes-clés ; d’une meilleure équité contre les discriminations raciales ; du répertoire international entre pièces de répertoire, nouvelles créations et recherches d’hybridation, du répertoire musical dans lequel puisent les chorégraphes. Federica Fratagnoli, enseignante-chercheuse en danse à l’Université Côte d’Azur et Sylviane Pagès, maîtresse de conférences en danse à l’Université Paris 8/laboratoire Musidanse, se penchent sur L’Orient décentré. Circulations de gestes et créations hybrides et observent plus particulièrement, dans le contexte de globalisation du début du XXIème siècle, la trajectoire des pratiques corporelles venant de l’Inde et du Japon, entre Kathak et Butô. Elles construisent, au fil des exotismes consommés par l’occident, puis de l’introduction du numérique et des nouvelles technologies, le concept positif d’hybridation.

© Éditions du Seuil
Patrick Germain-Thomas, docteur en sociologie, clôture l’ouvrage avec une réflexion sur Le contemporain : un questionnement pour la danse d’aujourd’hui. Partant du vocabulaire classique, de ses positions et mouvements, il interroge le nouveau rapport aux codes et aux règles et la construction de nouvelles esthétiques. Il note une certaine émancipation due à la pratique de l’improvisation et observe le déplacement des frontières, physiques comme celles liées aux imaginaires : danse et théâtre (Pina Bausch, Maguy Marin, Alain Platel, Jan Fabre et Jan Lauwers), danse et performance (La Ribot et Jérôme Bel), danse contemporaine et traditions africaines (rencontre entre Mathilde Monnier, Seydou Boro et Salia Sanou ; démarche de José Montalvo et Dominique Hervieu) cirque et arts mêlés (Yoann Bourgeois) ; brouillage des limites entre le plateau et la salle, les artistes et le public (Boris Charmatz). L’article, donc l’ouvrage, se termine sur la question de la mémoire et de la difficulté de garder trace de ces processus d’hybridation sans références parfois aux vocabulaires existants. Le contributeur y répond de ces quelques mots, prenant appui sur l’anthropologue Marcel Mauss : « La notion de technique du corps, qui s’applique à la danse, n’a de sens qu’en relation à la mémoire et à des mécanismes de transmission. »
Cette Nouvelle histoire de la danse en Occident. De la préhistoire à nos jours est à la fois érudite et accessible, donc agréable à lire. De ce fait, l’ouvrage s’adresse à tous les lecteurs, artistes et professionnels oeuvrant dans le domaine de la danse, autant que le grand public. On y lit l’évolution du geste et du rapport au corps, la symbolique du mouvement, individuel ou collectif, sacré ou profane et le processus de développement de la danse à travers le temps, sans fragmentation. Laura Cappelle qui l’a élaboré et qui a rassemblé l’équipe de spécialistes internationaux, en a traduit de l’anglais de nombreux articles, le travail accompli est immense. William Forsythe, qui en signe l’avant-propos indique : « Il est essentiel de savoir d’où on vient et à partir d’où on crée. Ma compréhension de l’histoire de la danse informe tout ce que je fais en studio. »
Le livre, qui a obtenu le Prix de la critique pour le théâtre, la musique et la danse, est abondamment illustré, notamment par deux cahiers de photos en couleurs d’une quinzaine de pages chacun, mais aussi tout au long de la narration. Un index des noms propres permet aussi de se renseigner facilement sur tel ou tel artiste. Si le récit trace les lignes de la danse en Occident, il propose aussi de nombreuses incursions au cœur de sources géographiques plus lointaines dont il reconnaît l’empreinte ou l’influence. On peut le lire comme on lit un roman, dans sa continuité, on peut s’y renseigner sur une époque ou un style déterminé, c’est une mine d’informations, hiérarchisées et très documentées.
Brigitte Rémer, le 9 décembre 2021
Nouvelle histoire de la danse en Occident. De la préhistoire à nos jours. Sous la direction de Laura Cappelle. Avant-propos de William Forsythe (355 pages) – Éditions du Seuil, septembre 2020. Ouvrage publié avec le concours du Centre national de la danse (31 euros).