D’après les récits de Paul Bereyter et Ambros Adelwarth, des Émigrants, de W.G. Sebald – un spectacle de Krystian Lupa – production Comédie de Genève – production déléguée et création, Odéon-Théâtre de l’Europe.
Le texte de W.G. Sebald, Les Émigrants, paru en allemand en 1992, édité en France en 1999 dans la traduction de Patrick Charbonneau, se compose de quatre récits aux tonalités mélancoliques, illustrés de photographies. Quatre histoires d’exilés que Sebald a connus et qu’il convoque par l’écriture. Trois d’entre eux sont Juifs d’origine allemande ou lituanienne, trois d’entre eux connaissent l’expatriation et le déracinement, certains, jusqu’au désespoir et à la mort. Ce roman est comme une autobiographie, il a valeur de transmission et pose la question de la conscience.
Né en Bavière en 1944 sous les bombardements, W.G. Sebald quitte son pays à l’âge de vingt-deux ans pour n’y plus revenir. Blessé par le silence de la génération de son père – sous-officier entré à la veille de la guerre dans la Wehrmacht, et négationniste – sur la guerre elle-même et sur le peu d’intérêt qu’intellectuels et artistes allemands ont manifesté face à la Shoah, aux destructions et aux exils, il part en Angleterre en 1966 où il vivra jusqu’à sa mort, accidentelle, en 2001. À Norwich, dans le Norfolk il enseigne la littérature à l’Université d’East Anglia et engage, à partir de 1980, un parcours d’écrivain très vite remarqué au Royaume Uni, aux États-Unis et en France.
Krystian Lupa s’empare de deux des récits, à la croisée de la fiction, du document et de l’enquête : celui de Paul Bereyter, l’instituteur de Sebald, qui couvre la première partie du spectacle, et celui d’Ambros Adelwarth, son grand-oncle, qui en constitue la seconde. Il remet sur le devant de la scène les photographies qui accompagnent les récits et construit son chemin théâtral menant de l’écran-tulle au plateau et du plateau à l’écran fond de scène avec une grande musicalité et de virtuoses apparitions-disparitions d’images, en fondu enchaîné. Lupa, après Sebald qui a écrit selon les réminiscences de sa mémoire, individuelle, familiale et sociale, est à la recherche de ses personnages, qu’il met en majesté.
Sur scène, on entre de plain-pied dans l’Histoire de Paul Bereyter par son avis de décès à Sonthofen et la coupure d’un article joint, portés en janvier 1984 à W.G. Sebald (Pierre Banderet) : « Avis qu’au soir du 30 décembre, soit dans la semaine suivant son soixante-quatorzième anniversaire, Paul Bereyter (Manuel Vallade) chez qui j’étais allé à l’école primaire, avait, à faible distance de la ville, à l’endroit où la ligne de chemin de fer, dans une courbe, débouche d’un petit bosquet de saules pour gagner la rase campagne, mis fin à ses jours en s’allongeant sur les rails au passage du train. » Et il apprend, au détour de l’article, que l’instituteur avait été révoqué cinquante ans plus tôt, en 1934, sur demande du Troisième Reich, car son grand-père était juif. L’envie de remonter le cours de son histoire se mit à le hanter. Il partit à sa rencontre en recherchant ceux qui l’avaient connu. La scénographie – cadre de scène cerné d’un fin filet de couleur rouge – nous place d’emblée dans une salle de classe où se trouvent quelques pupitres épars et un lit-cage sous la fenêtre, un poêle à bois au milieu de la pièce, un crucifix au mur. Aussi naturellement apparaît sur les tulles et écrans les images de La Classe morte de Tadeusz Kantor, metteur en scène polonais emblématique et plasticien, que Lupa, son compatriote, a plaisir à inviter et nous, à revoir. Ce même tulle accueille bien d’autres diagrammes comme le cadre du tableau noir, des plans de la classe que l’écrivain reconstitue, des photos de classe et photos de famille, des portraits. Les paysages sont de neige, ils se superposent parfois au plateau et Paul, à la flûte, joue du Schubert.
D’étape en étape Sebald rencontre Lucy Landau (Monica Budde) qui lui parle de Paul « presque tout entier consumé par sa solitude intérieure », Paul qui, après sa formation à l’école normale de Lauingen, qu’il comparait à une « maison de dressage pour instituteurs » et sortant de son année de probation l’été 1935 en Allemagne, avait sitôt reçu un avis officiel lui signifiant « qu’en raison de dispositions légales qu’il ne saurait ignorer, il n’est plus possible de le maintenir dans l’enseignement. » Une profonde défaite et violente blessure. Paul dit avoir souvent pensé au suicide, les écrivains qui s’étaient donné la mort le fascinaient. Exilé quelques années en France où il avait été contraint d’accepter un poste de précepteur à Besançon, il y avait rencontré Lucy Landau à Salins-les Bains, alors qu’elle lisait l’autobiographie de Nabokov, assise sur un banc de la promenade des Cordeliers. Sebald ne connaissait pas la vie de Paul, mais l’homme l’avait frappé : « Je n’étais que son élève, il m’a aidé à comprendre le monde, m’a initié. » Et dans sa recherche, il croise ses propres souvenirs avec les informations que lui transmet Mme Landau en tournant les pages d’un album photo annoté de sa main à lui. La vie entière de l’instituteur défile. Paul connaissait donc la France et le Jura où il allait certains étés. Il y avait rencontré une splendide jeune fille, Helen Hollaender dont il était tombé follement amoureux, (Mélodie Richard). « Elle était comme une eau profonde où Paul aimait à se mirer » commente Lucy. Après l’été elle était repartie à Vienne, lui en Allemagne, ils ne s’étaient pas revus. Elle disparut, sans nul doute déportée, avait poursuivi Lucy Landau.
Autre interrogation de Sebald face à Paul : il rentre en Allemagne au début de l’année 1939. « Six ans durant il allait servir, si l’on peut appeler ça ainsi, dans l’artillerie motorisée » puis, à la fin de la guerre, il obtient sa réintégration dans l’enseignement « sur les lieux même où on lui avait montré la porte. » Dans les cahiers noirs à couverture cirée dans lesquels Paul consignait sa vie, que Lucy Landau montre à l’écrivain, on apprend ensuite qu’il commence à perdre la vue et qu’aucune opération ne pourrait le sauver. Il décide de vendre son appartement dans sa ville de Sonthofen et demande à Mme Landau de l’y accompagner. C’est là, et à ce moment-là, qu’il met fin à ses jours. « Je ne suis pas à la bonne place » avait toujours pensé Paul Bereyter. Et Lucy Landau ajoutant « Il est bien difficile de savoir de quoi quelqu’un meurt. »
Après l’entracte, c’est vers un second destin, que nous emmène Krystian Lupa, celui d’Ambros Adelwarth selon le même principe de représentation, à partir de l’image répondant à l’interprétation des acteurs, sur le plateau. Sebald mène une véritable enquête, sur les pas de son grand-oncle, qu’il n’avait croisé qu’une seule fois à l’âge de sept ans au cours d’une rencontre familiale, dont la présence l’avait marqué et sur lequel rien n’avait plus jamais été dit. Ambros Adelwarth (Pierre-François Garel, Ambros jeune), avait en effet émigré aux États-Unis, où il fut majordome d’une riche famille juive, et plus particulièrement domestique personnel du fils de la famille, puis son compagnon de voyage et son amant. Ce fils de bonne famille, Cosmo Solomon, était un homme fragile et extravagant (Aurélien Gschwind), se retirant du monde, régulièrement et à la frontière de la folie. Deux tantes de Sebald – il l’apprendra plus tard – faisait assez régulièrement la traversée de l’Atlantique pour prendre de ses nouvelles : la tante Fini et la tante Theres. Veuve assez tôt, la première, qui était la plus proche d’Ambos et lui servait de confidente, ne poursuivit pas les voyages, contrairement à la tante Theres qui y alla souvent et dont la mort remonte à quelques années. Et Sebald cherche à décoder l’album photo familial, guidé par la tante Fini, qu’il rencontre (Laurence Rochaix).
Né en 1896, aîné de huit enfants et le seul garçon, Ambros Adelwarth était « d’une noblesse rare » dit la tante, il fut pendant plus d’une douzaine d’années aide cuisinier dans de grands établissements comme au Grand Hôtel de Montreux. C’est le périple de ces deux personnages, Ambos et Cosmo et leur relation tragique, qu’il nous est donné de voir. « Où finit le ciel, où commence la terre ? Nous sommes au bord des ténèbres, » clame Cosmo, par ailleurs très fort à la roulette et joueur de polo. Leur voyage à Constantinople fait penser à Mort à Venise, celui de Jérusalem est une vraie catastrophe, Cosmo s’absentant de plus en plus du monde, jusqu’à l’inconscience, et ne répondant plus. « Une malédiction semblait planer sur cette ville », écrivit Sebald. Cosmo ne revint jamais à sa vie d’avant. Il s’allongeait par terre et cachait son visage, percevant ce qui se passait en Europe. Son état de santé se dégrada, celui d’Ambros aussi. On les suit dans leurs errances, remettant leur vie dans les mains d’un médecin expérimentateur qui ressemble étrangement, dans l’interprétation proposée par Krystian Lupa, à Grün, médecin dans la pièce de S.I. Witkiewicz, Le Fou et la Nonne, face à Walpurg, le poète, vulnérable.
Sebald se rendit dans le centre de soins d’Ithaca où Ambros avait décidé « d’entrer de son plein gré à l’âge de soixante-sept ans pour n’en plus ressortir. » Les images sur écrans nous montrent une énorme bâtisse désaffectée pleine de graffitis et de dessins d’art brut au milieu de nulle part, comme une zone de non-droit où agit Fahnstock, le médecin hypnotiseur. Son assistant, le Dr Abramsky, à la retraite depuis quinze ans, l’y reçut au sanatorium de Samaria où il était resté vivre, entre le hangar à bateaux et le rucher. Il n’avait pas connu Cosmo mais avait bien connu Ambros. « Personne, vraisemblablement, n’imagine l’ampleur des souffrances et des malheurs qui se sont accumulés ici… Il est exact qu’Ambros Adelwarth n’a pas été placé ici avec sa famille mais qu’il s’est fait mettre, de son propre chef, sous surveillance psychiatrique… Lorsqu’il se tenait à la fenêtre et regardait dehors il donnait toujours l’impression de souffrir d’un mal incurable. » Et il se soumettait avec complaisance aux séances d’électrochocs, « ce qui, à l’époque, confinait à la torture ou au martyre… Aussi, lorsque Ambros, l’un des premiers à être soumis, dans notre établissement, à une série d’électrochocs s’étalant sur plusieurs semaines et même plusieurs mois, lorsque Ambros manifesta les signes d’une docilité qu’il n’avait pas eue jusque-là, Fahnstock ne manqua pas d’y voir le résultat du nouveau protocole, bien qu’en réalité, comme je commençais déjà à m’en douter à cette époque, cette docilité n’eût pas d’autre raison que le désir de votre grand-oncle d’annihiler en lui le plus radicalement et le plus irrémédiablement possible toute capacité de réflexion et de souvenir. » Et le Dr Abramsky poursuit : « Vers la fin, votre grand-oncle a été pris d’un raidissement progressif des membres et des articulations, sans doute dû à l’effet de la thérapie de choc. Bientôt il eut les plus grandes difficultés à rester autonome… » L’image ici prend plus d’importance encore, les lieux sont filmés de manière détaillée dans leur décrépitude et leur mystère, et alternent avec le plateau (Ambros Adelwarth, vieux, Jacques Michel – Docteur Abramsky, Philippe Vuilleumier). Sur le plateau comme sur l’image, on visualise les fauteuils servant aux séances d’électrochocs.
À travers ces thématiques que sont l’exil, l’émigration, les souvenirs traumatiques, les destructions du XXème siècle, la mémoire individuelle et la mémoire collective, la folie et le suicide, Krystian Lupa reconstruit, pas à pas, les itinéraires de Paul Bereyter et Ambros Adelwarth, que Sebald a finalement très peu connu et qui gardent leur mystère. « Notre rôle, dit Krystian Lupa, consiste à faire entendre les silences de Sebald sans pour autant les effacer. » Et il jongle avec l’image, filmée comme contrepoint à ce qui se déroule sur scène, et comme traces des souvenirs ou des paysages, intérieur et extérieur. Ses premiers travaux avec la vidéo remontent à 2008, avec Factory 2, son travail sur Andy Wharhol, même si on le connaît davantage au théâtre par la puissance de ses mises en scène des œuvres de Thomas Bernhard, Tchekhov, Kafka et Dostoïevski. Ici, la finesse de son travail rencontre l’écriture sobre et dense de Sebald par ces deux personnages qui ne trouvent plus leur place dans leurs pays et s’en sentent exclus, et qui n’ont d’autre issue que l’autodestruction et le suicide. Il retrouve la trace de ces exilés de l’intérieur et enrichit le récit par cette alternance acteurs sur scène / images d’archives / carnets intimes / topographie et images des lieux et des voyages / interviews de ceux qui les ont connus.
Né en Silésie en 1943, Krystian Lupa est marqué par le travail de Kantor et l’univers du réalisateur Andreï Tarkovski, on trouve chez lui cette même intransigeance. Cela aurait pu mener le spectacle vers le précipice car, compte tenu de différends, les représentations à la Comédie de Genève où devait avoir lieu la création du spectacle n’ont pu se tenir, ni, par voie de conséquence, celles du Festival d’Avignon. L’Odéon-Théâtre de l’Europe a pu assurer non seulement le relais, mais la création du spectacle. Il nous permet ainsi, par Krystian Lupa, un passeur virtuose qui assure ici l’adaptation, la mise en scène, la scénographie et la lumière du spectacle, d’accéder à l’écriture d’ombre et de lumière de W.G. Sebald, filtrée par une délicate direction d’acteurs.
Brigitte Rémer, le 28 janvier 2024
Avec : Pierre Banderet / Sebald – Monica Budde / Lucy Landau, Pierre-François Garel /Ambros Adelwarth,(jeune – Aurélien Gschwind / Cosmo Solomon – Jacques Michel / Ambros Adelwarth, vieux – Mélodie Richard / Hélène – Laurence Rochaix / Tante Fini – Manuel Vallade / Paul Bereyter – Philippe Vuilleumier Docteur Abramsky. Écriture, adaptation, mise en scène, scénographie, lumière Krystian Lupa – collaboration, assistanat, traduction du polonais vers le français Agnieszka Zgieb – création musicale Bogumił Misala – création vidéo Natan Berkowicz – costumes Piotr Skiba – directeur de la photographie Nikodem Marek – assistanat à la mise en scène et à la dramaturgie Maksym Teteruk. Créé le 13 janvier 2024 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe – production Comédie de Genève – production déléguée Odéon/Théâtre de l’Europe – coproduction Festival d’Avignon, Odéon/Théâtre de l’Europe, Le Maillon/Théâtre de Strasbourg scène européenne. Les droits d’adaptation théâtrale de W. G. Sebald sont représentés par The Wylie Agency (UK) Ltd.
Du 13 janvier au 4 février 2024, du mardi au samedi à 10h30, le dimanche à 15h. Odéon / Théâtre de l’Europe, Place de l’Odéon. 75006. Paris – métro Odéon – tél. : 01 44 85 40 40 – site : www.theatre-odeon.eu (durée 4h15 avec un entracte).












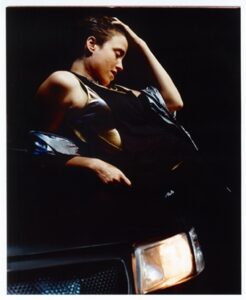





























Vous devez être connecté pour poster un commentaire.