 Exposition à la Galerie Europia, en avant-première au Festival d’art engagé, Sy-rien N’est Fait qui débute le 31 juillet 2019 – Sept artistes, vivant et travaillant en Syrie, exposent : Youssef Abdelke, Mouneer Al Shaarani, Abdallah Murad, Reem Tarraf, Suhail Thubian, Omran Younis, Zavien Youssef.
Exposition à la Galerie Europia, en avant-première au Festival d’art engagé, Sy-rien N’est Fait qui débute le 31 juillet 2019 – Sept artistes, vivant et travaillant en Syrie, exposent : Youssef Abdelke, Mouneer Al Shaarani, Abdallah Murad, Reem Tarraf, Suhail Thubian, Omran Younis, Zavien Youssef.
S’ils ne peuvent être là faute de visas, leurs oeuvres ont passé les frontières et montrent que la vie et les expressions de l’imaginaire et de l’espoir reprennent le dessus. Ces sept artistes plasticiens – dont une femme – de générations différentes, sont tous nés en Syrie et ont été formés dans leur pays, à l’École des Beaux-Arts de Damas, à la Faculté des Beaux-Arts de l’Université de Damas et pour l’un d’eux, sculpteur, à l’Institut d’Adham Ismail.
Né en 1951 à Qameshli, Youssef Abdelke vit et travaille à Damas. Son travail touche à différents domaines graphiques – affiches, illustrations, dessins humoristiques, couvertures de livres -. Il présente ici un dessin au fusain sur carton dans une déclinaison de gris, dessin très élaboré autour d’un poisson-symbole placé dans une boîte en bois, cherchant de l’oxygène, sans eau et sans espoir d’en sortir, boîte posée sur un plateau de bois dont chaque veine dessinée est d’une grande précision. Youssef Abdelke a participé à de nombreuses expositions dans les Pays Arabes et en Europe. Certaines de ses œuvres ont été acquises par des collectionneurs privés et par des institutions artistiques comme le Musée d’Art Moderne d’Amman, le Musée National du Koweit, le Musée de Digne-les-Bains, le British Museum et l’Institut du Monde Arabe à Paris.
Mouneer Al Shaarani est un calligraphe qui a étudié auprès du maître Badawi Al Dirany. Né en 1952 il vit et travaille à Damas et présente deux œuvres qui se caractérisent par une certaine géométrie, notamment une série de lignes parallèles finement agencées et vivantes. À travers la liberté de son geste face à cet art ô combien patrimonial, il célèbre une sorte de modernisme et de désacralisation. Ses œuvres ont été acquises par de nombreux musées des quatre continents et par des collectionneurs privés.
Avec un parcours artistique balisé par de nombreuses expositions personnelles et collectives – en Syrie, Turquie, Tunisie, au Liban et aux Émirats, ainsi qu’en Europe/France, Royaume-Uni, Bulgarie, Suisse – Abdallah Murad est considéré comme l’un des pionniers de l’expressionnisme abstrait dans le monde arabe et travaille dans l’asymétrie. Né à Homs en 1944, le tableau qu’il présente – acrylique sur toile – semble recouvrir une ancienne mosaïque effacée par le temps. Ses savants dégradés vont du jaune souffre/ocre jaune au vert camouflage/vert-de-gris, en une sorte de fondu-enchaîné. Abdallah Murad laisse un grand vide dans sa composition, habitée dans sa partie supérieure par de petites formes mi-fantomatiques mi-enzymatiques, en attente de réaction chimique.
Née à Homs en 1974, c’est au Département des arts graphiques/ Faculté des Beaux-Arts de l’Université de Damas que Reem Tarraf a appris le dessin, domaine dans lequel elle a travaillé plusieurs années ainsi que dans le design et l’éducation artistique. Elle a reçu le Troisième Prix du Salon des Jeunes Artistes Syriens, lors de son édition numéro 3, a participé à diverses manifestations artistiques au Canada, à Dubaï et aux États-Unis. Depuis 2016 elle se consacre exclusivement à ses activités artistiques. Elle présente ici deux grandes toiles qui accrochent le regard par leurs couleurs vives, l’une rouge, l’autre jaune, travaille les reliefs en y intégrant du papier froissé qu’elle enfouit dans ses couleurs. Un obstacle brun barre chacun des tableaux en leur centre, sorte de débris météorites.
Ce ne sont pas ses sculptures que Suhail Thubian montre ici, plus difficiles à sortir du pays, mais deux toiles de techniques mixtes où l’on lit le volume et l’architecture qui font la spécificité du sculpteur. La première mêle deux corps d’hommes qui se superposent comme en mouvement décalé et qui à peine se touchent avec la finesse de l’encre et de la plume. Placés dans un cercle jaune acrylique, ils pourraient évoquer L’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, avec sa règle de proportion des corps. La seconde toile représente une femme dessinée à la craie, allongée au sol la tête à demi enfouie sur un fond décalé là encore, bleu couvert de lettres d’or. Rêve-t-elle, ou comme le Dormeur du Val d’Arthur Rimbaud, a-t-elle « deux trous rouges au côté droit ? » Né en 1965 à Sweida où il travaille, Suhail Thubian a exposé en Syrie, au Liban, en Égypte et aux États-Unis.
Deux dessins au fusain sur carton, grands formats de Omran Younis plongent dans un univers mental déstructuré et dégagent une grande violence : Un loup efflanqué et enragé, gueule ouverte, s’apprête à fondre sur sa victime, située en-dessous. En contre plongée, face à lui, un enfant à la tête de mort, couleur verte, est allongé sereinement, dans une grande boîte-cercueil. L’extrême violence naît du contraste de la métaphore. Le second dessin est tout aussi rude, morceaux éclatés d’humains sous la supervision d’une figure-monstre rampante. Comme un ressassement, la répétition presque symétrique de têtes sans corps entraînées dans une danse des morts, est glaçante. Un dessin précis pour une représentation sans concession et de douleur qui n’est pas sans évoquer l’expressionnisme de la toile d’Edvard Munch, Le Cri, où le personnage se tient la tête – une tête de mort – entre les mains, où les yeux sont écarquillés d’épouvante et où la bouche, béante, pousse un cri silencieux. Né en 1971 à Hasakah, Omran Younis a reçu le Premier Prix du Salon des Jeunes Artistes Syriens, édition numéro 3. Ses œuvres font partie de nombreuses collections dans les Pays Arabes et dans le monde, et il expose à la Virginia Commonwealth Community Gallery de Doha, côtoyant d’autres grands artistes internationaux.
Né en 1983 à Al-Qamishli, Zavien Youssef est à trente-cinq ans le plus jeune des artistes exposant dans Art in Situ. Il vit et travaille à Damas et présente une grande toile aux couleurs chaudes, constituée de mille et une petites touches de peinture à l’huile accumulées, avec un travail sur la texture et dans l’épaisseur de la matière. Il présente une seconde œuvre, réplique de la première et comme sa maquette, légèrement plus petite et peinte sur carton. C’est lumineux et méditatif, dans un style expressionniste. L’artiste a obtenu en 2006, à l’âge de vingt-trois ans, le Premier Prix du Salon des Jeunes Artistes Syriens, il a participé à de nombreuses expositions individuelles ou collectives, au Moyen-Orient et en Europe. Zavien Youssef enseigne la peinture et le dessin, ses deux disciplines de prédilection auxquelles lui-même a été formé.
Dans cette petite galerie du VIIème arrondissement, Europia, pleine de simplicité, l’accrochage à lui seul parle et laisse filtrer la clarté derrière la douleur, et le partage d’espoir. « Qui suis-je encore quand mon visage, mon nom, la fleur de ma jeunesse, ma langue, ma voix, ma mémoire, sont restés là-bas ? habillée des débris de mon pays (…) » écrivait Fadwa Souleimane, exilée en France, dans son recueil de poésies, À la pleine lune, avant de disparaître. Aujourd’hui Là-bas est ici par la puissance de l’art et de ces sept artistes qui permettent de croiser nos regards avec intensité.
Brigitte Rémer, le 19 juillet 2019
Exposition Art in Situ, Galerie Europia, du 18 juillet au 2 août 2019, 16h30/19h30, du lundi au vendredi – métro : Saint-François Xavier – Tél. : 01 45 51 26 07 – Site : www .europia.org – et aussi : du 31 juillet au 4 août, Festival d’Art engagé/ Sy-rien N’est Fait… Concerts, cinéma, théâtre, débats, ateliers etc. aux Grands Voisins, Petit Bain, Point Éphémère, Galerie Fait et Cause – Site : https://asmlsyria.com/fr/syrien-nest-fait/


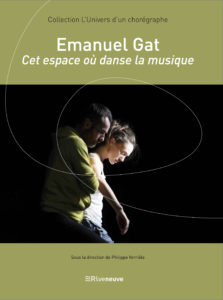







Vous devez être connecté pour poster un commentaire.