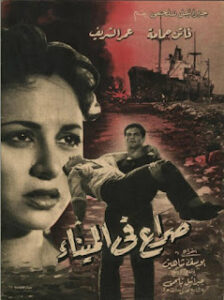Mise en scène, chorégraphie et textes Betty Tchomanga – Collaboration artistique et interprétation Emma Tricard, Folly Romain Azaman, Dalila Khatir et Adélaïde Desseauve aka Mulunesh – au Théâtre de la Bastille.
C’est une histoire de transmission qui traverse la grande Histoire autant que l’intime, à travers quatre récits d’expériences. Au point de départ un bref rappel historique nous plonge à vif dans le sujet, avec, en 1510, le premier soulèvement des esclaves à Sao Tomé-et-Principe ; en 1792, à Haïti, le soulèvement des Marrons, ceux qui s’échappent de la propriété des maîtres et tentent de survivre dans des lieux de la nature relativement inaccessibles ; l’abolition de l’esclavage par la Convention, en 1794, et son rétablissement dans les colonies françaises par Napoléon Bonaparte, en 1802.
Quatre actrices se succèdent ensuite au plateau, portraits croisés où chacune, dans sa singularité et son envie de partage, nous fait vivre et réagir sur le thème ô combien sensible de la colonisation/décolonisation, ses béances, ses blessures. La première, Emma Tricard, danseuse et chorégraphe, se présente comme « la cousine blanche de Betty », conceptrice du projet. Chaussée de baskets flashy, combinaison aux imprimés-carte du monde, elle fait parler son corps avec aisance et virtuosité.
Ce même tissu-monde sera le lien entre les parties et circulera parmi les spectateurs tandis que Ouidah, ville côtière du Dahomey de l’époque, aujourd’hui le Bénin, nous est montré comme plaque tournante du commerce des esclaves. Un acteur porteur de la culture locale apparaît, Folly Romain Azaman, il témoigne par la danse. À Ouidah le ciel est rouge, on pratique une multiplicité de langues dont le fon, l’une des langues majoritaires ; la danse funéraire du zinli rythmée par les crotales monte jusqu’à la transe ; les figures du costume sont déclinées ; le danseur nous initie au culte animiste du Vaudou, religion d’ordre cosmique. À Ouidah se trouve le temple des Pythons, le plus sacré des sanctuaires. « Je suis le fils de … » la liste des appartenances est longue de même que la liste des divinités – dieu de la guerre et des forgerons, dieu de la terre et des guérisons, esprit de la connaissance, dieu de l’orage et de la foudre -. « Je suis l’invisible… Je suis un buffle… Je suis un animal… Je suis folie… Je suis un fou… » Un premier roi du Dahomey avait marqué son opposition aux colons français, en 1890. Sur scène et dans le public, il appelle les ancêtres par le chant et la danse.
Puis apparaît Dalila Khatir en Mamma souriante et pleine d’humour, présence naturellement généreuse qui détend l’atmosphère et invite le public à prendre un verre de thé à la menthe, troisième séquence. Les plateaux circulent dans la salle, on dirait qu’on connaît depuis toujours cette belle figure totémique. Pourtant, couverte d’un voile noir, elle nous amène dans la tragédie, par le rappel de Sétif, en mai 1945 quand vingt-mille, peut-être même trente-mille Algériens furent massacrés par les Européens dans le Constantinois, évènement sur lequel est tombée une chappe de plomb. Petite fille d’un berger des Aurès, Dalila Khatir est née en France et n’a découvert l’Algérie qu’à quinze ans. Elle décrit les couleurs des Aurès et de l’Atlas, doré, ocre, le sable et l’horizon, son choc de découvrir ce pays, le sien, d’une grande beauté. Et elle nous embarque dans la mémoire de la mère spirituelle du Raï, Cheikha Remitti (1923-2006) mère aussi du Raï moderne, imprégnée de chant rural avant de se lancer dans ses apprentissages, chantant très librement l’amour, la femme, la sexualité, l’alcool, le choix de ne pas se marier, la liberté, censurée pour cela après l’Indépendance. Elle se met à chanter la joie de vivre, à danser, le drapeau algérien lui recouvrant la tête. Sa propre grand-mère entre dans le récit, « J’écoute ma grand-mère à l’hôpital psychiatrique d’Aix-en-Provence », elle lui parle de Dalida et de liberté. Celle qui se sent tiraillée des deux côtés de la Méditerranée et qui possède ses deux passeports, égrène les brimades d’une France ingrate quand en 1986 la loi Pasqua rejette certains ressortissants, y compris ceux nés sur son sol. Les drapeaux vont et viennent, d’Algérie et de France.
Adélaïde Desseauve aka Mulunesh, une jeune femme pleine d’énergie, baskets de boxeuse aux pieds et justaucorps noir, se raconte. « Je suis Mulunesh, Je suis Adelaïde Desseauve. Je suis née dans le berceau de l’humanité. » Originaire d’Éthiopie dans la fierté d’un pays jamais colonisé, orpheline, elle fut adoptée par une famille française. C’est de ce tiraillement entre ses deux cultures dont elle fait récit, dans un jeu de miroir. Une collerette de l’époque Renaissance autour du cou signe du classicisme, la danse traditionnelle Esqueta sur les rythmes du groupe ethnique amhara, mémoire de son pays, avec ses micro-mouvements ressemblant à des tremblements comme rotation des épaules et mouvements de la poitrine avant-arrière, ou encore balancements de la tête sur musique répétitive. Elle réinvente les pas de la mémoire par cette danse et, comme une reine de Saba, en fait la démonstration. « Je suis l’oubli, le trou de mémoire, face à la lune, au soleil, à la nuit. Je suis une langue, l’amharique. Je suis l’hybride, le bizarre, l’étrange… »
Le final réunit les quatre acteur-actrices dans un final de clair-obscur, autour du tissu monde, livre d’histoire à la main. Car le spectacle pose la question de la transmission de l’Histoire, d’où parle celui qui écrit l’Histoire ? Histoire(s) Décoloniale(s) # Portraits croisés propose un récit salutaire et décalé, à partir des corps et de la danse, dans le silence et dans les mots, dans les rythmes et les vastes territoires mal traités et mal considérés par le colonisateur, récits d’expériences intimes pleins de pudeur et de finesse où les non-dits ont même valeur que ce qui est énoncé, et qui blesse.
Née d’un père camerounais et d’une mère française, Betty Tchomanga s’est formée au Conservatoire de Bordeaux puis au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers (CNDC) sous la direction d’Emmanuelle Huynh. Un master 2 en lettres modernes en poche, à partir de 2019 elle se consacre principalement à son travail d’écriture et de recherche en tant que chorégraphe. Depuis la création de son solo, Mascarades, en 2019, elle mène une recherche sur le culte vaudou et ses représentations et s’intéresse aux récits qui relient l’Occident et l’Afrique à travers notamment l’Histoire coloniale. Ses pièces travaillent la notion de transgression au sens de dépassement. Histoire(s) Décoloniale(s) # Portraits croisés fait émerger des moments forts de l’Histoire qui seront à jamais des blessures. Conçu au départ pour les salles de classes comme une succession de solos, Betty Tchomanga a fédéré les récits qu’elle inscrit dans un geste de mise en scène et une théâtralité, des plus pertinents.
Brigitte Rémer, le 12 février 2026
Création lumière Eduardo Abdala – création sonore Stéphane Monteiro – scénographie et accessoires Eduardo Abdala et Betty Tchomanga en collaboration avec Vincent Blouch – construction Émilie Godreuil – costumes Marino Marchand en collaboration avec Betty Tchomanga ainsi que Théodore Agbotonou (costume Folly) et Mariette Niquet-Rioux (masque Mulunesh) – régie générale Stéphane Monteiro – régie lumière (en alternance) Eduardo Abdala et Tatiana Carret – régie son (en alternance) Stéphane Monteiro et Maëlan Carquet – stagiaire assistante à la mise en scène Ariane Chapelet – direction de production et diffusion Marion Cachan – administration Marion Le Guerroué.
Du 2 au 11 février 2026, au Théâtre de la Bastille, 76 rue de la Roquette. 75011. Paris – tél. : 01 43 57 42 14 – site : theatre-bastille.com